L’hypothèse la plus en vogue actuellement est celle dite « paléolithique » : on imagine que jadis, des hommes ont récolté quelques grappes de vigne sauvage, qu’elles furent ensuite entreposées dans des récipients de l’époque. Cette réserve ainsi constituée a sans doute été mangée sur plusieurs jours et, pendant ce temps, le poids d’entassement des grappes a libéré du jus. Le raisin étant un fruit à taux de sucre élevé, une fermentation naturelle via levures indigènes s’est produite. La dégustation fortuite de ces baies et de ce jus fermenté, par la singularité des parfums et les effets de l’alcool, aurait alors donné envie aux hommes qui ont pu l’expérimenter de renouveler la chose.
La variété Vitis vinifera vinifera est représentée à ce jour par 8’000 à 10'000 cépages dans le monde. Si l’on s’interroge encore sur les centres de domestication secondaires d’Europe occidentale, Patrick McGovern (directeur scientifique du laboratoire d’archéologie biomoléculaire de la cuisine et des boissons fermentées) nous apprend que la plus ancienne trace de vin aujourd’hui répertoriée serait localisée à Hajji Firuz Tepe (Iran), avec une datation avoisinant 5400-5000 av. J-C. Cette datation a été permise grâce à une jarre autrefois remplie de vin « résiné » provenant d’une « cuisine » dans une résidence de l’ère Néolithique. Des découvertes récentes nous emmèneraient même jusqu’à plus de 7000 ans av. J-C ! Il faut savoir à ce sujet que les datations se font techniquement par analyse du spectre infrarouge de l’acide tartrique, présent en grande quantité dans le raisin.

Quant aux origines géographiques des lieux de domestication primaire de la vigne, à l’heure actuelle, le centre d’origine consensuel considéré par les botanistes, archéologues et historiens serait la Transcaucasie (Arménie, Géorgie) ; alors que de récentes découvertes génétiques, archéologiques et linguistiques pointeraient plutôt le sud-est de la Turquie (Anatolie), aux sources du Tigre et de l’Euphrate, non loin de cette zone bien connue que l’on nomme le Croissant Fertile. Trois des huit variétés fondatrices de l’agriculture (blé, orge, seigle) trouvent également leur origine dans cet endroit, plus précisément dans la région de Karaçadağ.

José Vouillamoz
A ce jour, José Vouillamoz et Patrick McGovern ont dans leurs cartons un projet de comparaison génétique des anciens cépages du Proche-Orient avec les populations primitives de vignes sauvages, afin d’approfondir la connaissance de l’origine de la vigne et du vin.
Voilà donc un petit résumé de la mini-conférence tenue dernièrement par José Vouillamoz au CAVE, préalable à la dégustation d’une série de vins turcs, géorgiens et arméniens qu’il avait lui même sélectionnés et acheminées en Suisse.
Parmi les 14 cuvées dégustées, on peut – subjectivement – retenir les suivantes :
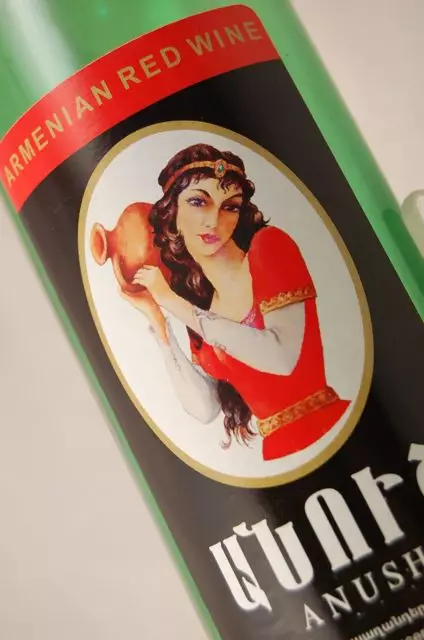
Arménie, Domaine Vedi Alco, 1993, vin rouge issu du cépage Areni : sans doute vinifié avec « les moyens du bord », il offre un nez poivré avec une acidité volatile haute – et peut-être aussi une pointe de brett – qui fait penser à certains vins « nature ». La bouche est cohérente avec le nez, elle est à la fois tannique et souple, et donc intéressante par cette combinaison particulière, à l’instar de certains vins italiens.
Turquie, Domaine Vinkara, Doruk Kirmizi Sek Sarap 2010, vin rouge issu du cépage Öküzgözü (qui signifie « Oeil de bœuf ») : il rappelle un Humagne rouge avec des notes de fruits noirs, de cerise burlat, de végétal et un profil un peu réducteur sur le cassis. En bouche, le vin donne pas mal de fruit ; il est tannique, assez court et finit amer. Un cru original.
Turquie, Philipp Gfeller & Ines Rebentrost, cuvée Kirmizi 1 Ortahisar 2009, vin rouge issu des cépages Nebbiolo, Carmenère, Tempranillo, Syrah et Merlot : Ines Rebentrost, est œnologue et travaille au Schlossgut Bachtobel à Weinfelden (Schaffhouse). Elle a vécu cinq ans en Turquie et a récemment mis sur pied ce projet de création d'un vignoble pour produire un grand vin en Turquie. Notes de tomate séchée avec des nuances boisées discrètes et cacaotées. Les tanins sont doux, savoureux et patinés, délivrant une forme de plaisir dans la texture. Un beau vin… malgré le recours un peu « étonnant » à des cépages internationaux dans une région aussi antique !
Géorgie, Château Mukhrani, 2010, vin rouge issu du cépage Shavkapito : nez presque pinotant sur le jus de cerise, fruité et floral, rehaussé d’un boisé élégant ; la bouche est tannique, on retrouve le fruit du nez mais aussi un grain présent. Belle trame pour ce vin souple et ferme : on dirait une sorte de pinot noir « appuyé ». Une très jolie bouteille.
Géorgie, Château Mukhrani, 2010, vin rouge issu du cépage Shavkapito : nez presque pinotant sur le jus de cerise, fruité et floral, rehaussé d’un boisé élégant ; la bouche est tannique, on retrouve le fruit du nez mais aussi un grain présent. Belle trame pour ce vin souple et ferme : on dirait une sorte de pinot noir « appuyé ». Une très jolie bouteille.

Géorgie, Alaverdi Monastery, Qvevris 2010, vin blanc de macération en qvevri (jarre en terre cuite) issu du grand cépage Rkatsiteli : premier nez sur des notes de pomme avec des nuances terpéniques et d’écorces d’agrumes : il possède une forme de complexité qui évoque certains Xerès, en moins oxydatif. La bouche continue bien le nez, c’est très frais, sapide, tenu et précis, avec beaucoup d’acidité et des tanins provenant de la longue macération. Un vin fascinant, troublant, qui nous a permis de finir la soirée en beauté !
Pour en savoir plus sur ce domaine hors du commun et ce mode de vinification qui est ni plus ni moins que le plus ancestral connu, voir la vidéo suivante…
Cet article a été écrit avec le concours de José Vouillamoz, que je remercie au nom du CAVE pour sa science et sa passion communicative à faire découvrir les épisodes les plus ancestraux de l’histoire et de la civilisation du vin !
Nous rappelons à ce sujet la sortie prévue en octobre du futur ouvrage de référence The Grape, par Jancis Robinson, Julia Harding et lui-même, chez Penguin.
Nous remercions enfin vivement Wines of Turkey, The Qvevri Foundation et Georgian Legend Ltd pour leur collaboration et aide dans l’organisation de cette dégustation.

3 Comments
Si je peux me permettre une petite précision, l’analyse IR réalisée sur les résidus contenus dans les amphores permet effectivement de confirmer la présence d’acide tartrique et de tartrate de calcium (éléments "communs" du vin) mais ne donne pas une datation "directe" du vin, plus précisément de ses résidus.
Ce sont des méthodes nucléaires comme le 14C (très utilisé en archéologie préhistorique) ou même la thermoluminescence (des résidus brulés) qui peuvent donner une datation absolue de vestiges situés dans la même couche archéologique que les amphores (ou dans des niveaux antérieurs et/ou postérieurs).
Cette comparaison permet donc ce qu’on appelle une datation relative (ou indirecte).
Par ailleurs, sous réserve de retrouver des restes d’ADN dans le collagène des os (ce qui est très rare compte tenu de la fragilité de cette molécule), l’étude de la racémisation des acides aminés (en général, l’alanine) permet également une datation du vestige (moins précise toutefois que le 14C).
Pour info : les acides aminés ont la propriété de faire tourner la lumière vers la droite (dextrogyre) ou vers la gauche (lévogyre). Dans tout être vivant, seul existe l’isomère lévogyre. A sa mort, l’isomère lévogyre se transforme peu à peu en isomère dextrogyre. l’étude du rapport D/L par CPG couplée à une spectro de masse permet de déterminer l’age de la mort.
Cordialement
Bruno
Bien aimé au Wine Bar de Bordeaux samedi dernier Le Ribolla Gialla 2005 de Gravner.
Puissance et personnalité pour ce vin original, légèrement rancioté.
Pour apporter une précision vu que l’article date de 2013. Depuis, des recherches scientifiques ont montré que le vin ne serait pas originaire du Caucase, mais des pays autour d’Israël.